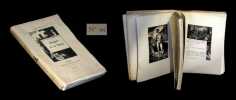7769 books for « bertrand p »Edit
-
Type
Art print (1)
Artists book (3)
Book (7754)
Magazine (5)
Maps (3)
Music sheets (12)
Old papers (1)
Photographs (5)
-
Latest
Last 3 days (4)
Last month (50)
Last week (43)
-
Language
Dutch (2)
English (2)
French (7775)
Romanian (1)
Russian (4)
-
Century
17th (14)
18th (51)
19th (297)
20th (3341)
21st (1251)
-
Countries
Belgium (317)
Canada (50)
China (1)
Côte d'Ivoire (14)
Denmark (26)
France (6793)
Germany (10)
Greece (7)
Italy (4)
Spain (35)
Switzerland (523)
United States of America (4)
-
Syndicate
ALAC (46)
CLAM (23)
CLAQ (13)
CNE (5)
ILAB (3638)
NVVA (41)
SLACES (41)
SLAM (3472)
SNCAO (17)
Topics
- Africa (32)
- Agriculture (29)
- Algeria (79)
- Aquitaine (19)
- Archaeology (52)
- Architecture (75)
- Army (23)
- Autographs (49)
- Auvergne (20)
- Belgium (38)
- Bertrand aloysius (19)
- Bertrand louis (457)
- Bertrand pierre (45)
- Biography (132)
- Botany (21)
- Brittany (34)
- Catholicism (20)
- Children’s books (134)
- Christianity (35)
- Cinema (36)
- Civilisation (25)
- Colette (20)
- Comic strip (43)
- Cooking (37)
- Dedication (47)
- Drawings (20)
- Economics (96)
- Education (53)
- Education - morals (34)
- Essays (25)
- Ethnology (24)
- Fine arts (84)
- First edition (79)
- Florence (30)
- Flornoy bertrand (61)
- Fox (26)
- Genealogy (32)
- Geneva (34)
- Geography (97)
- Geology (32)
- Gille (38)
- Greece (23)
- Guegan bertrand (29)
- Guide books (32)
- Helvética (39)
- History (424)
- Ile de france (28)
- Industrial arts & crafts - fine arts (27)
- Journalism (19)
- Jouvenel bertrand de (25)
- Law (68)
- Literature (537)
- Lorrain (23)
- Magazine (31)
- Mathematics (28)
- Medicine (68)
- Meyer bertrand (86)
- Military arts (21)
- Miller (28)
- Music (30)
- Napoleon i (23)
- Navy (39)
- Newspapers press (82)
- Nobility (19)
- Painting (30)
- Paris (48)
- Philosophy (197)
- Photography (91)
- Poetry (49)
- Poirot-delpech bertrand (117)
- Policy (85)
- Political economy (21)
- Provence (35)
- Psychology (85)
- Pyrenees (51)
- Regionalism (62)
- Religions (81)
- Review (41)
- Reviews (37)
- Revolution 1789 (44)
- Sciences (69)
- Scores (23)
- Simone (39)
- Social sciences (25)
- Sociology (36)
- Songs (23)
- Spain (34)
- Switzerland (22)
- Testimonies / stories (19)
- Theatre (20)
- Theology (24)
- Travel (29)
- United states (25)
- Various (89)
- War (71)
- Youth (29)
DUBY Georges, Armand WALLON, Georges BERTRAND, Claude BERTRAND, Marcel LE GLAY, Guy FOURQUIN, Emmanuel LE ROY LADURIE, Hugues NEVEUX, Jean JACQUART, Marcel AGULHON, Gabriel DESERT, Robert SPECKLIN, Michel GERVAIS, Marcel JOLLIVET, Yves TAVERNIER
Reference : 8759
Hstoire de la FRANCE rurale, sous la direction de Georges DUBY et Armand WALLON. TOME I : LA FORMATION DES CAMPAGNES FRANCAISES, des origines à 1340, sous la direction de G. DUBY. Pour une histoire écologique, par Georges et Claude BERTRANDAvant l'histoire, par Gérard BAILLOUDLa GAULE romanisée, par Marcel LE GLAYLe premier Moyen Âge,par Guy FOURQUIN Le temps de la croissance, par Guy FOURQUINAu seuil du XIVe siècle, par Guy FOURQUINTOME II : L'AGE CLASSIQUE DES PAYSANS DE 1340 A 1789, sous la direction d'E. LE ROY LADURIE. Déclin et reprise : la fluctuation biséculaire (1330-1560), par Hugues NEVEUXImmobilisme et catastrophes (1560-1690), par Jean JACQUARTDe la crise ultime à la vraie croissance (1690-1789), par Emmanuel LE ROY LADURIETOME III : APOGEE ET CRISE DE LA CIVILISATION PAYSANNE DE 1789 A 1914, sous la direction de Etienne JUILLARD. L'essor de la paysannerie (1789-1852), par Maurice AGULHONLes campagnes à leur apogée (1852-1880), par Gabriel DESERTL'ébranlement (1880-1914),par Robert SPECKLINTOME IV : LA FIN DE LA FRANCE PAYSANNE DE 1914 A NOS JOURS, par Michel GERVAIS, Marcel JOLLIVET et Yves TAVERNIER L'agriculture dans l'économie nationale, Familles et exploitations, Le paysan dans ses villages Syndicalisme et politiqueL'état et les paysans
4 tomes reliés toile avec jacquette - 18x22,5 - 624 pp, 624 pp, 573 pp, 672 pp- 1975, 1975, 1976,1976 - éditions DU SEUIL, Paris. Collection "l'univers historique". Nombreuses photographies dans et hors texte.
ROUCH Jean, André MIGOT, Bertrand FLORNOY, R. P. DUPEYRAT, Frank ELGAR, Philippe TAILLIEZ, Paul-Emile VICTOR, Norbert CASTERET, Haroun TAZIEFF, Gaston REBUFFAT, Bernard PIERRE, Alain BOMBARD, André LIOTARD, Jacques PICCARD et FOUQUET Gaétan et André LEJARD avec le concours de "connaissance du Monde"
Reference : 5441
Explorations.Tome 1 : Connaissance de l'AFRIQUE noire, par Jean ROUCH Sur les routes secrètes de l'ASIE , par le Dr André MIGOTLes jungles de l'AMERIQUE du sud, par Bertrand FLORNOYPeuples inconnus de l'OCEANIE, par R.P. DUPEYRATDans les brumes du passé,par Frank ELGARLe trésor des fonds sous-marins, par le capitaine de frégate Philippe TAILLIEZ.Tome 2 : Dans les profondeurs de la terre, par Norbert CASTERETLes volcans et leur secret, par Haroun TAZIEFL'homme et les cimes, par Gaston REBUFFAT et Bernard PIERREConnaissances de la mer, par le Dr Alain BOMBARDDu Pôle sud au Pôle nord, par Paul-Emile VICTORDe la srtatosphère aux abysses, par Jacques PICCARD.
2 tomes reliés avec jacquette - 22x31 - 398 pp et 398 pp - 1961 - éditions le livre de PARIS, Paris.Nombreuses illustrations dans et hors texte, en couleurs et noir et blanc.Ouvrage conçu et réalisé sous la direction de Gaétan FOUQUET et André LEJARD avec le concours de "Connaissance du Monde".
LA MONTAGNE DE BEAUNE.croquis et silhouettes
1652 relié - 16.5x25 - 144pp - imprimerie RENE BERTRAND Beaune - 1933 - illustrations d'émile GOUSSERY
notes archéologiques sur CORCELLES - LES - MONTS et le MONT - AFRIQUE ( COTE D'OR)
broché - 16 x 24 - pp - éditions auteur - sans date
Histoire d'Espagne.
broché - 12x19 - 533 pp - 1941 - Fayard, Paris.
Nouvelle édition revue et augmentée.
ISABEAU DE BAVIERE ou l'épouse d'un roi fou.
relié - 14,5x19,5 - 179 pp - 1965 - éditions RENCONTRE , Lausanne.Collection "ces femmes qui ont fait l'histoire", nouvelle série "égéries et femmes de lettres", dirigée par Joël SCHMIDT.Illustrations hors texte.
les femmes fidéles
relié cuir - 19x13 - 291 pp - 1937 - éditions librairie PLON , les petits-fils de Plon et NOURRIT , Paris .Il a été tiré 200 exemplaires sur papier Alfa , numérotés de A1 à A200 réservés aux selectons LARDANCHET. Exemplaire n° 63 .
bel reliure
les noms de famille en BOURGOGNE et FRANCHE COMTE.Histoires et anecdotes.
broché - 17 x24 - 329pp - 2000 - éditions archives et culture
mon roman policier : FEUX DE POSITION
broché - 11x16 - 32pp - éditions Ferenczi - 4ème trimestre 1955 - N° 400 - super état , rare car le papier est tres fragile - la collection comporte 560 parutions
envoi possible d'un scan de la couverture
BLANCS ET NOIRS
broché - 64 pp - 11X16. - sans date - collection PRINTEMPS n°12- super état , rare car le papier est très fragile -
envoi possible d'un scan de la couverture
OIES ET CANARDS Production moderne et rationnelle
Broché - 13,5 x 18 - 125 pp - année 1979 - Editions la maison rustique - illustrations de François Cuvelier - collection : Faire soi-même -
Réveil matin fait par Monsieur Bertrand pour réveiller les prétendus savants mathématiciens de l’Académie Royale de Paris, &c.
Hambourg, Imprimé par Bertrand libraire ordinaire de l’Académie de Bertrand, 1674-1676. In-8 de (36) pp. 1 f.bl., 75 pp., 3 planches hors texte.Ne trompez plus personne ou Suite du Reveil-matin des pretendus savans Matematiciens de l’Academie royale de Paris. Hambourg. Bertrand, 1675. In-8 de (24)-69-(1) pp.Le monde désabusé ou la Demonstration des deux lignes moyennes proportionnelles. Hambourg, 1675. In-8 de 40 pp.Ce n’est pas la mort aux rats ny aux souris, mais c’est la mort des mathématiciens de Paris et la démonstration de la trisection de tous triangles. Hambourg, 1676. In-8 de (28)-14-(6) pp.4 pièces reliées en 1 vol. petit in-8 (16,5 x 10 cm), vélin rigide, dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge (reliure moderne).
Édition originale de la plus grande rareté des quatre pamphlets de l’artilleur-mathématicien Bertrand de La Coste adressés à l’Académie royale des sciences qui rejeta sa Machine d’Archimède présentée en 1671. Colonel d’artillerie à Hambourg, Bertrand de la Coste retourna dans sa ville de garnison où il reçut en 1674 l’approbation de Frédéric Wilhem, électeur de Brandebourg qui accueillit favorablement cette découverte, et fit délivrer à l’auteur un certificat qu’on peut lire parmi les pièces liminaires avec l’« Extrait du Privilège et le Passeport de l’Académie de Bertrand », société fictive et satirique créée pour venger Bertrand de La Coste de l’académie parisienne.3 planches hors texte illustrent le premier des quatre opuscules (le Réveil matin), dont le portrait de l’auteur, une épigraphe gravée et une grande planche repliée qui représente les armoiries de l’Académie : un écusson chargé d’une botte de foin supporté par deux ânes dont l’un porte des grelots attachés aux oreilles avec des rubans (le directeur Caricavy) et l’autre une devise, Le premier professeur de mathématiques de sa Société (Roberval) ; un troisième âne est posé en cimier avec Niquet gravé au-dessus de sa tête et ce titre : Voilà trois renommés mathématiciens. Pierre de Carcavy (1603-1684) était directeur de l'Académie royale des sciences, Antoine de Niquet (1641-1726), ingénieur du Roi protégé de Colbert et Vauban, et Gilles Personne de Roberval (1602-1675) l’inventeur de la balance à deux fléaux. Les trois autres opuscules sont illustrés de nombreux diagrammes dans le texte.« On peut rapprocher du cas Abraham Bosse un autre exemple de marginalisation académique, touchant dix ans plus tard un autre protestant, persuadé lui aussi de détenir, seul contre tous, une vérité géométrique universelle, et ayant lui aussi voué son existence à la démonstration d’une question au moins aussi problématique, pour les siècles passés et à venir, que ne l’était celle des fondements objectifs de la perspective. Il s’agit de Bertrand de La Coste, auteur de quatre opuscules publiés à Hambourg en 1674, 1675, 1676 dont le rejet par l’Académie des Sciences en 1671 n’est pas moins révélateur des normes implicites nouvellement engendrées par cette institution que l’exclusion de Bosse pour l’Académie de peinture et de sculpture. Militaire autodidacte et précédemment auteur, en 1663 d’un ouvrage consacré à la résolution de la quadrature du cercle, Bertrand de La Coste avait envoyé à Colbert en 1671 les plans d’une machine d’Archimède, machine dite à mouvement perpétuel. Colbert l’ayant adressé à l’Académie des Sciences pour expertise, il s’y présenta la même année avec une maquette exécutée à ses frais par un ébéniste. Mais après avoir été soumis par les Académiciens à un rapide examen oral de ses connaissances mathématiques, il fut renvoyé sans qu’on lui eût même laissé présenter son invention (…) C’est bien de cette classe de “visionnaires mystiques” (Montucla) que La Coste eut le douloureux privilège d’être le premier représentant avant que le phénomène ne se généralisât au 18e siècle (…) c’est d’une fictive “Académie Bertrand“ que La Coste se réclame pour admonester la même académie décrivant ainsi un processus de mise à l’écart du monde scientifique qui illustre parfaitement la frontière qui commençait alors à s’établir entre professionnels et amateurs. Car c’est bien dans cette dernière catégorie que se voit impitoyablement rejeté l’artilleur-mathématicien, de manière d’autant plus radicale que - plus que son invention pas même examinée - c’est sa personne même qui se voit disqualifiée et rejetée, du fait que l’examen préalable qu’on lui fait, contre toute attente, subir est destiné à évaluer sa compétence scientifique bien plutôt que son produit. Cette expérience va plonger La Coste dans une véritable crise d’identité qu’il va tenter de résoudre en se livrant, à travers ses quatre pamphlets à une dénonciation en règle » (Nathalie Heinich). Salissures marginales sur le premier feuillet de titre, petit manque de papier sur la planche repliée sans atteinte à la gravure.2 exemplaires complets des 4 parties au Catalogue collectif de France (BnF, BM La Rochelle).Caillet, II, 5915bis : « Ouvrage extrêmement rare » ; Brunet, VI, 7756 ; Arthur Dinaux, Les Sociétés badines, bachiques, chantantes et littéraires (1867) I, p. 84 ; Blavier, Les Fous littéraires, p. 354 ; Nathalie Heinich, Arts et sciences à l'âge classique. In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 66-67, mars 1987. Histoires d’art. pp. 47-78.
Gaspard de la nuit.
Paris, Ambroise Vollard, 1904. Un vol. au format pt in-4 (254 x 188 mm) de xxiii - 310 pp., en feuilles, sous couverture titrée.
Un des 100 exemplaires numérotés du tirage sur Chine (deuxième papier après les 20 de tête sur Japon) de cette ''in téressante publication''. (in Carteret). Il s'agrémente - ici en premier tirage - de délicates compositions par Armand Séguin (213 dessins gravés par Tony, Jacques et Camille Beltrand). ''Cet artiste, épigone de Gauguin, ne connut pas durant sa brève existence, le succès ou, tout du moins, l'attention des amateurs qu'il pouvait espérer. Son activité artistique s'accomplit surtout dans la région de Pont-Aven. Gauguin l'encouragea, allant jusqu'à écrire la préface de son exposition en 1895. Il participa à la fondation et aux premières manifestations du groupe des Nabis. Il illustra Gaspard de la nuit et Manfred de Byron''. (in Bénézit). Considéré comme l'inventeur du poème en prose, Gaspard de la nuit demeure l'oeuvre qui fit passer Bertrand à la postérité.Avec Sainte-Beuve, auteur d'une notice, David d'Angers se chargea de la publication de Gaspard de la nuit, qui aboutit enfin en novembre1842. Le 15janvier1843, la Revue des Deux Mondes fit paraître une critique de Paul de Molènes qui signalait un certain charme et de la nouveauté, mais laissait transparaître le scepticisme de son auteur, au contraire d'Émile Deschamps, qui, dans La France littéraire, évoqua l'ouvrage avec enthousiasme. Cependant, cette édition originale, établie à partir d'une copie plus ou moins fautive du manuscrit original déposé par Bertrand chez Renduel et réalisée par l'épouse du sculpteur, comportait de nombreuses erreurs. En 1925, une nouvelle édition, de Bertrand Guégan, établie sur une copie réalisée par ses soins sur un manuscrit original - peut-être celui qu'Élisabeth Bertrand vendit à Jules Claretie -, corrigea les erreurs les plus flagrantes. En 1980, Max Milner reprit le texte de l'édition Guéguan, enrichi de «pièces détachées», d'«appendices» et d'un solide appareil critique. Ce n'est qu'à partir de 1992, avec l'acquisition par la Bibliothèque nationale d'un manuscrit calligraphié par l'auteur, qu'il fut permis de publier un volume conforme aux vœux du poète, tant du point de vue de la mise en page que de l’illustration de l’œuvre, et, par ses variantes, qu'il s'agisse de ratures ou d'ajouts, d'apprécier son travail de création. «D'un caractère formel novateur, d'une esthétique remarquable, et d'une valeur littéraire inestimable, ce manuscrit peut être à juste titre considéré comme une véritable œuvre d'art, influencée par les motifs religieux du Moyen Âge et sa mystique». En 1862, Charles Baudelaire expliqua, dans sa lettre-dédicace à Arsène Houssaye du Spleen de Paris:«J'ai une petite confession à vous faire. C'est en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le fameux Gaspard de la Nuit, d'Aloysius Bertrand (un livre connu de vous, de moi et de quelques-uns de nos amis, n'a-t-il pas tous les droits à être appelé fameux?) que l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue, et d'appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d'une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu'il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque.» Par ces lignes, Baudelaire a contribué à attribuer la paternité du poème en prose à Bertrand, que d'autres auteurs donnent plutôt à Maurice de Guérin. C'est lui, de même, qui décida Charles Asselineau à réimprimer, avec Poulet-Malassis, Gaspard de la Nuit en 1868.Les Symbolistes achevèrent de faire passer Bertrand du statut de «petit romantique» à celui d'auteur culte: Auguste Villiers de l'Isle-Adam publia dès 1867 plusieurs pièces de Gaspard dans sa Revue des lettres et des arts ; Stéphane Mallarmé témoigna toute sa vie d'une grande révérence à l'égard de cet auteur, qu'il avait découvert à vingt ans; Jean Moréas poussa son admiration jusqu'à regretter que Verlaine ne l'ait pas inclus parmi ses «poètes maudits». Autre figure du monde poétique français de la seconde moitié du xixesiècle, Théodore de Banville cita, dans sa préface de La Lanterne magique (1883), Bertrand et Baudelaire comme ses modèles. Toutefois, la reconnaissance de son œuvre n'intervint qu'au xxesiècle. C'est Max Jacob qui, après Baudelaire, contribua le plus à attirer l'attention sur Bertrand, qu'il présenta comme l'inventeur du poème en prose. Par la suite, les surréalistes contribuèrent largement à la popularité de Bertrand, décrit comme un «poète cabalistique». André Breton le qualifia ainsi dans son Manifeste du Surréalisme (1924) de «surréaliste dans le passé».Maurice Ravel mit en musique, pour le piano, les poèmes Ondine, Le gibet et surtout Scarbo, pièce de virtuosité unique (Gaspard de la nuit, 1908). Carteret IV, Le Trésor du bibliophile / Illustrés modernes, p. 71 - Bénézit IX, Dictionnaire des peintres, p. 506 - Bailly-Herzberg, Dictionnaire de l'estampe en France, p. 297. Dos légerement ridé. Rousseurs sur les plats ; très rares dans le texte. Nonobstant, très belle condition. Exemplaire non coupé. Bulletin de souscription conservé.
Pierre Lavedan . R Lizop . B Sapène . Commission des fouilles de St Bertrand de Comminges
Reference : 9631
les fouilles de saint bertrand de comminges 1920 -1929 . Rapport sur les fouilles de saint bertrand de comminges . 1929-1930 . Rapport sur les fouilles de saint bertrand de comminges en 1931 , 1932 . De 1933 a 1938 premiere partie . Deuxième partie . Troisième , quatrième et cinquième parties
E Privat . Toulouse 1929 à 1945
Très bon état Ensemble de 7 plaquettes différentes brochées et reliées dans un fort volume toilé , dos lisse avec pièce de titre .1er : les fouilles de saint bertrand de comminges 1920 -1929 . 62 pages Illustrées de 7 fig in texte et 20 planches hors texte (1929) 2ème : Rapport sur les fouilles de saint bertrand de comminges . 1929-1930 . 37 pages illustrées de 5 fig et 12 planches hors texte (1931) 3ème : Rapport sur les fouilles de saint bertrand de comminges en 1931 . 62 pages illustrées de 9 fig et 13 planches hors texte (1932) 4ème: Rapport sur les fouilles de saint bertrand de comminges en 1932 , 75 pages illustrées de 11 fig et 9 planches (1933) 5ème : Rapport sur les fouilles de saint bertrand de comminges de 1933 à 1938 , première partie , 99 pages illustrées de 1 fig et 12 planches ( 1940) 6 ème , deuxième partie , 41 pages illustrées de 14 planches (1943) 7ème : Troisième , quatrième et cinquième parties , 85 pages illustrées de 23 planches (1945) Les planches sont parfois dépliantes . Histoire Archéologie Saint-Bertrand-de-Comminges Pyrénées Haute-Garonne - largeur/hauteur :23x28 cm - poid : 2570 g - nombre de pages : p. - langue : Français
Bertrand Denis Bertrand Perrine Bertrand Anne-Jeanne
Reference : 24492VPPG
ISBN : 9782913288010
Daumas (Maurice), ed. - André Leroi-Gourhan - Daniel Faucher - André Haudricourt - Georges Contenau - Georges Goyon - Jean Deshayes - Paul-Marie Duval - Huard, Schrimpf, Durand, Destombes - Jean Filliozat - Gaston Wiet - Jean Théodoridès - Mlle Chita de la Calle - Bertrand Gille - Bertrand Gille - Daniel Faucher - Marguerite Dubuisson, Jacques Payen et Jean Pilisi - André Garanger - Pierre Mesnage - Armand Machabey - Paul Gille - Hubert Landais - Maurice Audin - André Garanger - Jean-Baptiste Ache - Daniel Faucher - Arthur Birembaut - Walter Eudier - Paul-R. Schwartz - S.W. Shukhardin - Philip W. Bishop - Alexandre Herléa - Jules Guéron - Robert Moïse
Reference : 101366
(1962)
Histoire Générale des Techniques - 4 premiers volumes de cette série - Tome 1 - Les origines de la civilisation technique - Tome 2 - Les premières étapes du machinisme - Tome 3 - L'expansion du machinisme - Tome 4 - Techniques de la civilisation industrielle - Energie et matériaux , (1. Apparition et premier développement des techniques - Antiquité méditerranéenne - Asie du sud et Extrême-orientale - Islam et Byzance - Amérique précolombienne - Moyen Age en Occident, Ve siècle- 1350 - 2. Les XVe et XVIe siècles en Occident - Exploitation des produits naturels - Arts mécaniques - Transports et voies de communication - Production de l'énergie - Techniques militaires - Construction et bâtiment - Techniques d'expression - 3. Moyen de production et d'énergie - Les Industries mécaniques - Transports et communications - Techniques militaires - Construction et aménagement de l'habitation urbaine - Extraction et transformation - Les industries du textile - Techniques d'expression - Diffusion du progrès technique - 4. La production d'énergie - Electricité industrielle - Grande industrie chimique)
Presses Universitaires de France - P.U.F. , Histoire Générale des Techniques Malicorne sur Sarthe, 72, Pays de la Loire, France 1962 Book condition, Etat : Bon relié, cartonnage éditeur, pleine toile imprimée crème, pièce de titres bleue, sans la jaquette Petit et fort In-4 4 vol. - 3127 pages
168 planches et de très nombreuses figures en noir et blanc (complet de toutes les planches, 48, 48, 48 et 24) 1ere édition, 1962 Contents, Chapitres : 1. Préface générale par Maurice Daumas, xvi, Texte, 652 pages, 48 planches - 2. Introduction de Maurice Daumas, xix, Texte, 750 pages, 48 planches - 3. Introduction de Maurice Daumas, xxiv, Texte, 884 pages, 48 planches - 4. Introduction de Maurice Daumas, xxviii, Texte, 754 pages, 24 planches - TOME 1. - 1. Apparition et premier développement des techniques : André Leroi-Gourhan : Introduction - Sociétés primitives - Premières sociétés agricoles - Complexe technique du Néolithique - Daniel Faucher : Origine et premiers développements de l'agriculture - André Haudricourt et M. Daumas : Les premières étapes de l'utilisation de l'énergie naturelle - 2. Antiquité méditerranéenne : Georges Contenau : Mésopotamie et pays voisins - Georges Goyon : Antiquité égyptienne - Jean Deshayes : Les techniques des grecs - Paul-Marie Duval : L'apport technique des romains - 3. Asie du sud et Extrême-orientale : Huard, Schrimpf, Durand, Destombes : Les techniques de l'Extrême-Orient ancien - Jean Filliozat : La technologie en Inde - 4. Islam et Byzance : Gaston Wiet : Le Monde musulman, VIIe-XIIIe - Jean Théodoridès : L'Empire byzantin , Vie-Xve - 5. Amérique précolombienne : Mlle Chita de la Calle : Techniques précolombiennes - 6. Moyen Age en Occident, Ve siècle- 1350 par Bertrand Gille : Conditions et premiers pas d'une évolution des techniques - Le problème des transports - Energie et machinisme - Les techniques de transformation des matières - Les techniques d'assemblage - Les techniques d'organisation de l'espace - Techniques et civilisation de l'Occident médiéval - Bibliographie générale (nb : chaque partie est suivie d'une bibliographie thématique) - Index des noms, des matières, des figures et tableaux, tables - TOME 2. - 1. Les XVe et XVIe siècles en Occident - Bertrand Gille : Ingénieurs et techniciens - Le problème des transports - Essor du machinisme - Les techniques d'acquisition - Techniques de transformation des matières - Techniques d'assemblage - Les techniques militaires - Les techniques d'organisation de l'espace - L'évolution de la civilisation technique - 2. Grandes étapes de transition : 2.1. Exploitation des produits naturels : Daniel Faucher : Techniques agricoles - Maurice Daumas : Extraction des produits chimiques - Marguerite Dubuisson, Jacques Payen et Jean Pilisi : Industrie textile - 2.2. Arts mécaniques : Maurice Daumas et André Garanger : Le machinisme industriel - Pierre Mesnage : La construction horlogère - Armand Machabey : Les techniques de mesure - 2.3. Transports et voies de communication, par Paul Gille : Transports terrestres - Transports maritimes et fluviaux - 2.4. Production de l'énergie - 2.5. Techniques militaires - 2.6. Construction et bâtiment - 2.7. Techniques d'expression : Hubert Landais : Les techniques des métiers d'art - Maurice Audin : Imprimerie - Bibliographie générale (nb : chaque partie est suivie d'une bibliographie thématique) - Index des noms, des matières, des figures et tableaux, tables - TOME 3. - 1. Moyen de production et d'énergie - Maurice Daumas et Bertrand Gille : Les sources traditionnelles d'énergie - La machine à vapeur - La puissance mécanique et sa mesure - 2. Les Industries mécaniques : Maurice Daumas : Les facteurs mécaniques du progrès industriel - André Garanger : Le machinisme industriel - Maurice Daumas : La petite mécanique et les origines de l'automatisme - Pierre Mesnage : La Chronométrie - M. Daumas et André Machabey : L'unification du système des mesures et les débuts de la mécanique de précision - 3. Transports et communications : M. Daumas et Paul Gille : Les routes, les ponts et les véhicules routiers - Rivières, canaux et ports - Navires et navigation - Chemins de fer - Premières étapes de l'Aérostation - Naissance du télégraphe - 4. Techniques militaires, par Paul Gille - 5. Construction et aménagement de l'habitation urbaine, par Jean-Baptiste Ache et M. Daumas - 6. Extraction et transformation : Daniel Faucher : L'évolution des techniques agricoles - Arthur Birembaut : L'industrie minière - Bertrand Gille : L'évolution de la métallurgie - M. Daumas : La montée de la grande industrie chimique - 7. Les industries du textile : Walter Eudier et Jacques Payen : La filature des fibres textiles - Jacques Payen et Jean Pilisi : Le tissage et l'apprêt mécanique - Marguerite Dubuisson : La bonneterie - Paul-R. Schwartz : La coloration partielle des étoffes - 8. Techniques d'expression - Maurice Audin : L'mprimerie - 9. Diffusion du progrès technique : S.W. Shukhardin : Développement des techniques en Russie, 1700-1830 - Philip W. Bishop : L'introduction des techniques modernes sur le nouveau continent - Bibliographie générale (nb : chaque partie est suivie d'une bibliographie thématique) - Index des noms, des matières, des figures et tableaux, tables - TOME 4. - 1. La production d'énergie : Jacques Payen : Machines et turbines à vapeur - Alexandre Herléa : Moteurs à air chaud - Les moteurs à combustion interne - Jules Guéron : Energie nucléaire - 2. Electricité industrielle : Robert Moïse et Maurice Daumas : Période d'approche - Invention du courant industriel - Courant alternatif - Utilisations immédiates du courant électrique - Grande expansion du Xxe siècle - 3. Grande industrie chimique - Maurice Daumas : Evolution des procédés classiques - Matières organiques naturelles - Science et technique chimiques - Moyens physiques - nouvelle industrie de l'azote - Des matériaux artificiels aux produits de synthèse - Chaque partie est suivie d'une bibliographie thématique - Index des noms, des matières, des figures et tableaux, tables Bon ensemble des 4 premiers volumes de cette séries éditée sous la direction de Maurice Daumas, dans leurs premières éditions, sans la jaquette, sinon bon état, cartonnages propres, intérieur sinon très frais et propre, papier à peine jauni, 4 volumes homogènes, complet des 168 planches hors-texte, cela reste un bel exemplaire de cette série devenue peu courante avec de très nombreuses figures en noir sur l'histoire des techniques - NB : manque le tome 5 édité postérieurement - Maurice Daumas (Béziers, le 19 décembre 1910 Paris, le 18 mars 1984) est un chimiste et historien français, l'un des pionniers de l'histoire des techniques en France. Il consacra une partie essentielle de son travail à l'archéologie des techniques et au patrimoine industriel français. (source : Wikipedia)
Le Mirage oriental.
Perrin, 1910, in-12, xii-455 pp, reliure demi-basane aubergine, dos à 5 nerfs soulignés à froid et fleurons dorés, pièce de titre basane havane, couvertures conservées (rel. de l'époque), bon état
La débâcle de la couleur locale. – Mirage et réalité. – L'Orient qui bouge : la plèbe, la misère, le travail. – Jeunes-Turcs. Jeunes-Egyptiens. Chrétiens et Juifs. – Nationalisme, séparatisme et révolution. – Les Ecoles. – La mêlée des Religions. – L'Orient contre l'Europe. — Par Louis Bertrand (1866-1941), romancier et essayiste, une figure de proue du nationalisme français de l’entre-deux-guerres, qui, par son radicalisme, rappelle Maurice Barrès et Charles Maurras. Professeur agrégé à Alger de 1891 à 1900. Il effectue son premier voyage en Égypte et en Grèce en 1906. Ce voyage d'une année fut entrepris pour la Revue des Deux Mondes à l'initiative de Brunetière. Louis Bertrand en rapporta ce livre où il dénonce le Mirage oriental ; dans cette « enquête au pays du Levant », il rejette l’idée de « fraternité universelle » et, au nom de la Nation, appelle à « se rebarbariser » pour pouvoir « [s’adapter] aux conditions du monde moderne, qui est, en grande partie, un monde barbare ». Une conception colonialiste associant l’altérité à une menace permanente. Voir par exemple comment il représente la ville orientale du Caire : « Nulle part au monde, pas même à Jérusalem, je n’ai respiré un pareil bouquet de puanteurs. Des effluves asphyxiants se dégagent du fleuve obstrué d’immondices et de charognes d’animaux ; le sol où l’on marche n’est qu’un dépotoir, un entassement de débris innommables que la chaleur recuit et liquéfie en des chimies invraisemblables. C’est d’une telle véhémence, d’une concentration d’arômes si nuancée, que l’odorat se pervertit et qu’à la longue on croit humer, en un prodigieux élixir, tous les fumets troublants de l’exotisme » (p. 59). — "M. Louis Bertrand, qui aime, comme on sait, à bousculer nos illusions et ne s'embarrasse pas des traditions ni des légendes, même dans les sujets les plus traditionnels et les plus légendaires, nous offre un livre tout bouillant d'images et d'idées sur le Mirage oriental. « Il y a cent ans, nous dit l'auteur, à l'époque tumultueuse et trouble du romantisme, alors que Turcs, Arabes et Japonais n'étaient guère pour nous que des sujets de pendules ou de paravents, des prétextes à poèmes byroniens et à romans exotiques, on pouvait s'amuser à décrire leurs vestiaires et ignorer leurs âmes : cela ne tirait pas à conséquence. Aujourd'hui, ces gentillesses ne sont plus de saison. On ne saurait trop connaître des gens qui, demain, peuvent être nos adversaires et qui se souviennent toujours d'avoir été nos vainqueurs »." (Ph.-Emmanuel Glaser, Le Mouvement littéraire, 1909) — "Avec un merveilleux talent d'exposition, en une langue, modèle d'élégance et de clarté françaises, M. L. Bertrand s'attache à dissiper les illusions des « lecteurs éblouis des Orientales », à dénoncer tous les mirages : mirage de la couleur locale, mirage des élites intellectuelles, mirage de la rénovation turque, mirage de la régénération islamique, mirage de la pénétration occidentale, mirage de la mission laïque ; rien n'est oublié ! Son enquête comprend tout l'Orient classique, depuis l'Égypte jusqu'à la péninsule des Balkans. L'auteur a visité le Levant à un moment particulièrement intéressant. « L'Orient se transforme et la mentalité musulmane avec lui, mais dans un sens qui n'est peut-être pas celui que nous souhaitons... période de crise, où les moeurs anciennes, entamées par les mœurs nouvelles, composent un spectacle hybride et déconcertant (p. 39) », mais la fréquentation des élites orientales ne l'a pas empêché de découvrir le fanatisme sommeillant au fond des masses populaires (p. 82) (...) Dans l'ordre intellectuel, il faut placer « les Syriens et les Grecs à peu près ex aequo. et, enfin, bon dernier, le gros Turc d'Asie » (p. 413-414)- Dans la masse musulmane, M. L. Bertrand distingue fort à propos ce qu'il appelle les élites Jeunes-Turcs et Jeunes-Egyptiens. « Il y a lutte chez eux entre la culture européenne et toute leur hérédité mentale. Quand cette culture ne leur est pas une gêne, ils s'en servent comme d'un trompe-l'œil. Leur éducation les a doués d'une double face : ils présentent l'une ou l'autre, selon qu'ils s'adressent à un coreligionnaire ou à un Occidental. Ils possèdent deux claviers intellectuels. ils changent de clavier en changeant d'auditoire. » (p. 220.) Nous demeurons en plein mirage oriental ! « Ce livre risque de mécontenter beaucoup de monde. » L'esquisse psychologique de l'âme levantine, impossible de le nier, n'est pas flatteuse pour les chrétientés orientales. Le livre ne satisfera pas davantage les musulmans. Moins que jamais les Jeunes-Turcs se montrent disposés à accueillir la critique ; les conseils les plus désintéressés leur paraissent du dénigrement, des dénis de justice. Au lieu de nous arrêter à ces récriminations, recueillons plutôt les leçons se dégageant de cette longue et fructueuse enquête. Commençons par une douloureuse constatation après un siècle de diplomatie, d'intervention en faveur des réformes et des opprimés, après les sacrifices de nos missions, en dépit de leurs œuvres de bienfaisance et d'instruction, malgré la pluie d'or déversée sur le Levant par l'épargne et la philanthropie occidentales, l'Europe, à l'heure présente, y trouverait difficilement des amis désintéressés. Avec des nuances dans la désaffection, au gré des affinités ethnographiques et religieuses, toutes ces races reconnaissent un ennemi commun « Cet ennemi, c'est nous-mêmes, nous Européens, qui, par nos entreprises industrielles, nos opérations financières, nos agiotages effrénés (auxquels d'ailleurs les Orientaux s'associent avec empressement), bouleversons sans cesse les conditions économiques de ces pays. » (p. 144-) Jeunes-Turcs et Jeunes-Égyptiens essayent de s'organiser une patrie. « Or, une patrie se fonde toujours contre quelqu'un. » (p. 166.) Cette patrie sera turque et islamique au dedans, xénophobe a l'extérieur ou elle ne sera pas ! Voici la conclusion du “Mirage oriental” : Là-bas au Levant, on est « las de notre tutelle et de notre ingérence... le monde asiatique est en proie aune sourde effervescence. Les tendances de la masse en Égypte, comme en Turquie, sont au fond plus réactionnaires que révolutionnaires. » (p. 441). Dans ces tendances réactionnaires, faites de fatalisme, de résignation confiante en la volonté de Dieu, il est permis, à la suite de M. L. Bertrand, de reconnaître un des atouts de l'Orient islamite. « Avec une pareille force de résistance, on vient à bout de toutes les épreuves, on défie les hommes et la durée. » (p. 444.) On peut attendre l'heure. « Allah est avec les patients » répète le Qoran. Et les musulmans attendent « Plus prolifiques que les Européens, ils ont une religion et une armée. Les Turcs sont, par excellence, une nation militaire. » A cette nation militaire, il manque encore un corps d'officiers. Cette lacune, nous travaillons à la combler : Nous recommençons toutes les folies de l'Empire romain à la veille des invasions. Nous initions les Barbares à notre tactique, nous leurs vendons nos armes, nous leur montrons à s'en servir. Ces gens qui ne connaissent ni nos scrupules, ni nos lassitudes, ni nos névroses, dont les âmes nous sont fermées, dont les pensées sont à mille lieues des nôtres, ces apprentis de la guerre moderne se chargent de nous enseigner un peu de psychologie. Il faut que nous-mêmes, tout en restant des intellectuels, nous redevenions capables d'agir comme des Barbares, si nous ne voulons pas être mangés par les Barbares. (p. 448). Si, après ces avertissements, le mirage oriental continue à nous amuser, on n'en pourra rendre responsable le courageux écrivain. Son livre nous paraît un des plus méritants consacrés à la matière en cette dernière décade." (Henri Lammens, Revue Etudes, 1910)
12 L.A.S. à Marc Barbezat.
PONTALIS (Jean-François et Jean-Bertrand). 12L.A.S. à Marc Barbezat. 26p. d’une fine écriture format in-8. Neuilly sur Seine (le plus souvent), octobre 1942 —5 mars 1949, enveloppes cons. « L ’ancien enfant prodige, qu’a-t-il fait de ses dons? Quel parti a-t-il tiré de ses lectures, de sa proximité avec des écrivains et des poètes —Cocteau, Genet, Olivier Larronde, Violette Leduc, Louise de Vilmorin, bien d’autres —, de ses rêveries prolongées que, pendant tout un temps, suscitaient les fumées de l’opium ? Qu’est devenu son « journal » où, j ’imagine, il n’épargnait personne, ni ses amis ni lui-même, lui qui s’était exclamé à mon adresse : “Publier de son vivant, c’est d’un vulgaire ! Posthume, mon bon Jean-Bertrand, posthume !” De lui, à part quelques pages inachevées, il ne reste rien. Même le “posthume”, il l’a refusé ». Une rare et très intéressante correspondance par le frère «maudit» du célèbre psychanalyste. Jean-Bertrand Pontalis fut l’élève de Jean-Paul Sartre, il collabora à la revue Les Temps modernes et fut en analyse avec Jacques Lacan. Il deviendra une sommité du monde psychanalytique à partir des années soixante. Il est co-auteur du célèbre Vocabulaire de la psychanalyse que l’on désigne toujours comme le Laplanche et Pontalis. Écrivain et éditeur, on lui doit d’avoir créé les collections L ’un et l’autre, chez Gallimard, après Connaissance de l’inconscient. Au terme d’une existence bien remplie, Jean-Bertrand, Jibé, publiera un troublant récit autobiographique intitulé Frère du précédent (Gallimard, 2006, Prix Médicis essai) qu’il consacre aux rapports avec son ainé, Jean-François. Il brosse par petites touches l’histoire d’une complicité devenue jalousie puis haine farouche… « Même s’il est mort depuis quelques années, je n’arrive toujours pas à savoir s’il me détestait ou s’il m’aimait. Mais, ne serait-ce que par pudeur, je ne voulais pas m’en tenir à une simple description de cette relation. J ’ai donc choisi de m’intéresser, par le moyen d’une série de jeux de miroirs, à d’autres couples de frères, réels ou de fiction : Marcel et Robert Proust, Vincent et Théo Van Gogh, les frères Champollion. Ou encore les Goncourt : à la mort du cadet, Jules, on surnomma le survivant la veuve — le mot couple prend là toute sa force ». Dans ces lettres il est question de différents projets de publications que Jean-François Lefèvre-Pontalis destine à L ’Arbalète, la revue dirigée par Marc Barbezat, en premier lieu d’un cahier consacré à Raymond Radiguet avec textes, documents inédits, études et hommages. Ses lettres, assez vibrionnantes, témoignent d’une belle maîtrise du langage ainsi que d’une solide connaissance du monde des écrivains et de l’édition. Rappelons qu’à cette époque on attend que Jean-François Lefèvre-Pontalis prenne une place de premier choix parmi les écrivains de la nouvelle génération. On parle de lui, ni plus ni moins, comme d’un nouveau Marcel Proust. Il est souvent question de Max Jacob, de Jean Cocteau ou de Jean Hugo avec lesquels il est en intimité. Deux lettres concernent le numéro spécial de l’Arbalète sur les romanciers américains, Eugene O’Neil, Erskine Caldwel ou Djuna Barnes. Il est aussi question de Jean Genet, Georges Auric, Christian Bérard, Olivier Larronde ou Michel Cournot (“un jeune grand ami à moi, il tient ses travaux très secrets, mais il écrit on ne peut mieux, j ’espère lui soutirer un jour une petite pièce, et vous la faire parvenir…”). Son frère cadet, Jean-Bertrand, est le plus souvent associé à ses projets. Jean-François évoque même “un numéro de notre façon ; The Waste-paperbasket « La Corbeille à papier », un recueil de poèmes et de proses à quatre mains, “que nous voulions présenter chez vous, et signer les frères Pontalis…” Suivent ces lignes : “Nous avons compris que notre imagination verbale n’est pas l’Imagination, Reine du vrai. Nous vous donnerons peut-être quelque chose d’autre un jour ; en attendant vous aurez mon travail de commis sur Radiguet. (…) Mon frère vous a envoyé un début d’un roman de jeunesse (Les Dimanches Illustrés) sur le conseil de Sartre. Je vous recommande mon frère. En rêve l’autre nuit on m’a dit que : non content d’avoir du talent il voulait avoir du génie. Et c’est ça même”. (…) “J ’espère que vous le rencontrerez en venant à Paris. Il habite St. Germain des Prés, et vous pourriez prendre rendez-vous. Il ne me ressemble pas du tout, heureusement pour lui”. À partir de la fin 1944 les rapports commencent à se désagréger entre J.-F. L.-P. et Marc Barbezat. C’est tout naturellement que Jean-Bertrand va prendre la relève. Ce sont les dernières lettres de cette précieuse correspondance.


Phone number : 33 01 48 04 82 15
[J. BRUNEAU, H. BOUYER, V. FRIESE et R. BERTRAND] - COLLECTIF - textes de Henry Amer, Georges Aubin, Luc Benoist, René Bertrand, Henri Bouyer, Jean Bruneau, Jacques Catta, Yves Cosson, Victoire Friésé, Roger Chagneau, Edouard Huc, Jacques Lechat, Jean de Malestroit - Illustrations de J. BRUNEAU, H. BOUYER, V. FRIESE et R. BERTRAND
Reference : 8295
Cahiers de l'Académie de Bretagne - 1975 - Villes
NANTES, Imp. Chantreau - 1974 - In-8 - Broché - Couverture rempliée - Exemplaire numéroté (n° 182) - Illustrations NB de René Bertrand, Jean Bruneau, Henri Bouyer et Victoire Friésé, dans le texte et HT - 107 pages - Bon exemplaire
Contient des textes de Henry Amer, Georges Aubin, Luc Benoist, René Bertrand, Henri Bouyer, Jean Bruneau, Jacques Catta, Yves Cosson, Victoire Friésé, Roger Chagneau, Edouard Huc, Jacques Lechat, Jean de Malestroit. - Livraison a domicile (La Poste) ou sur simple demande en Mondial Relay.- ATTENTION: Colis recommandé uniquement sur demande (parcel recommended on request). Si vous désirez un remboursement équivalent au montant de votre achat, en cas de perte détérioration ou spoliation, demandez-nous expressément un envoi en recommandé ( if you wish a repayment equivalent to the amount of your purchase, in case of loss - deterioration or despoliation, ask us expressly for a sending recommended)- Conditions de vente : Les frais de port sont affichés à titre Indicatifs (pour un livre) Nous pouvons être amené à vous contacter pour vous signaler le surcoût du au nopmbre de livres achetés ou du poids de ceux-ci. - Conditions of sale : The shipping costs are displayed as an indication (for one book) We may need to contact you to inform you of the cost of the additional shipping depending on the weight and the number of books- Possibilité d'envoi par Mondial-Relay - Réception en boutique sur rendez-vous. Librairie G. PORCHEROT - SP.Rance - 0681233148
Gravure originale signée de Bertrand Dorny : carte de voeux pour 1992
1992 aucune reliure Carte de voeux de Bertrand et Anne Dorny pour 1992. Dépliant sur papier d'Arches portant au premier plat une gravure originale gaufrée en quatre couleurs de Bertrand Dorny signée à la mine de plomb. Feuille : 10,5 x 21,5 cm, sujet : 9 x 17,5 cm.
Bel état. Parfait
Reynès, P. (Pierre Bertrand Marie), 1829-1877.- Pierre-Bertrand Marie Reynès,
Reference : 9845
(1860)
DU LAIT,these presentée à la Faculté de Medecine de Montpellier le 31/01/1860, relié avec : Etudes sur le synchronisme et la délimitation des terrains crétacés du sud-est de la France par Pierre-Bertrand Marie Reynès,
1860 Montpellier BOEHM 1860,in4 84p,envoi autographe auteur sur page de titre,relié avec Paris :E. Savy,1861. 116 p. : 1 f. de dépl. ; 26 cm. Thèse Th. : Sci. : Marseille : 1861. ,en un volume in4 ,reliure demi chagrin,exemplaire unique truffé d'un portrait aquarellé en frontispice de l'auteur par REBOUL,du discours manuscrit prononçé par REBOUL,,Aide naturaliste au Museum d'Histoire naturelle de Marseille ,sur la tombe de P.Reynès le 10/03/1877;à l'entete de la Ville de Marseille,et du faire part de deces ,
cachets bibliotheque,dos abimé avec manques importants,trés rare document de et sur l'ancien Directeur du Museum d'Histoire naturelle de Marseille ,dans l'etat, Remise de 20% pour toutes commandes égales ou supérieures à 100 €
 Write to the booksellers
Write to the booksellers