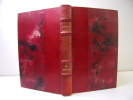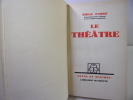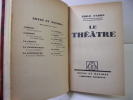Émile Fabre
Le Théâtre
Sommaire; L'auteur - la mise en scène, décors, costumes, mobilier - l'acteur. Émile Fabre (1869-1955) est un auteur dramatique français. Il est administrateur général de la Comédie-Française de 1915 à 1936. volume in8, 180x135, relié demi cuir, 203pp, très bel état intérieur, couvertures conservées. Paris Notes & Maximes, Hachette 1936 ref/98
Reference : CZC-8540
Bookseller's contact details
Livres anciens & Autographes
M. Pascal Poidevin
06 35 23 34 39
Payment mode

Sale conditions
Livraison dans le monde entier - Paiement Paypal, Chèque, Virement Bancaire, Mandat, Chorus
5 book(s) with the same title
[Louis FranÃois Roubiliac] - Bindman, D and M. Baker
Reference : 052070
(1995)
ISBN : 0300063334
Roubiliac and the Eighteenth-Century Monument. Sculpture as Theatre.
Bindman, D and M. Baker: Roubiliac and the Eighteenth-Century Monument. Sculpture as Theatre. London: Yale University Press, 1995. 409 pages. 288 black and white illustrations. Cloth. 25.6x19.2cms.cms. Comprehensive examination of Louis FranÃois Roubiliac's tomb sculpture and monuments, covering commissions, settings, the design processes involved, social and religious conditions, etc. .
Comprehensive examination of Louis FranÃois Roubiliac's tomb sculpture and monuments, covering commissions, settings, the design processes involved, social and religious conditions, etc.
Spectacular Flirtations; Viewing the Actress in British Art and Theatre 1768-1820
Perry, Gill: Spectacular Flirtations; Viewing the Actress in British Art and Theatre 1768-1820. New Haven and London: 2007. 256pp with 50 colour and 85 monochrome illustrations. Hardback. 28x23cms. An analysis of femininity in 18th century theatrical culture through visual imagery from artists such as Gainsborough, Reynolds, Hoppner and Lawrence featuring actresses such as Sarah Siddons, Dorothy Jordan, Mary Robinson and Elizabeth Farren.
An analysis of femininity in 18th century theatrical culture through visual imagery from artists such as Gainsborough, Reynolds, Hoppner and Lawrence featuring actresses such as Sarah Siddons, Dorothy Jordan, Mary Robinson and Elizabeth Farren. Text in English
LES ANNALES DU THEATRE ET DE LA MUSIQUE-1896
PREFACE PAR M A CLAVEAU-BROCHE-464 PAGES-12 CM X 19 CM-ACADEMIE NATIONALE DE MUSIQUE-COMEDIE FRANCAISE-THEATRE NATIONAL DE L'OPERA COMIQUE-THEATRE NATIONAL DE L'ODEON-THEATRE DU GYMNASE-THEATRE DU VAUDEVILLE-THEATRE DE LA RENAISSANCE-THEATRE DES VARIETES-THEATRE DU PALAIS ROYAL-THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN-THEATRE MUNICIPAL DE LA GAITE-THEATRE MUNICIPAL DU CHATELET-THEATRE DE L'AMBIGU COMIQUE-THEATRE DES NOUVEAUTES-THEATRE DES BOUFFES PARISIENS-THEATRE DES FOLIES DRAMATIQUES-THEATRE CLUNY-THEATRE DEJAZET-THEATRE DE LA REPUBLIQUE-THEATRE DE L'ELDORADO-THEATRE DES MENUS PLAISIRS-SPECTACLES DIVERS-CONCERTS DU CONSERVATOIRE-CONCERTS COLONNE-CONCERTS LAMOUREUX-CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DECLAMATION-NECROLOGIE-LA PRESSE THEATRALE EN 1896-EN GRANDE PARTIE NON COUPE-DOS CASSE AVEC MANQUES-INTERIEUR TRES SAIN-(JDG39)
PAUL OLLENDORFF COUVERTURE SOUPLE ETAT ASSEZ BON
[ Importantes archives du "Théâtre d'Art de Bordeaux", anciennement «Théâtre d’art Charles Chabert» ] Exceptionnel lot d’une centaine d’affiches du «Théâtre d’art de Bordeaux», tous formats, dont nombreuses affiches de la période 1942-1945 - 6 cahiers de recueils manuscrits détaillant le déroulement des représentations du théâtre d’art de Bordeaux (avec noms des acteurs, et appréciation, et nombreux programmes) de 1951 à 1976 ; Lot de 5 albums photos de représentation et photos diverses - 5 recueils de coupures de presse - Diplômes de la Diète générale de Moncrabeau aux nom de Charles Chabert et Line George
6 recueils de coupures de presse : 1 vol. grand in-8, recueil de coupures de presse relatant les représentations et les concours d’art du «Théâtre d’art» de Bordeaux de juillet 1942 à décembre 1962 ; 1 vol. grand in-8, recueil de coupures de presse relatant les représentations et les concours d’art du «Théâtre d’art» de Bordeaux de décembre 1962 à mai 1968 ; 1 vol. in-4 br., Bottin de la Gironde 1952, utilisé comme recueil de coupures de presse relatant les représentations du «Théâtre d’Art» et du «Théâtre des Enfants» de Bordeaux, et d’autres troupes, de 1952 à 1958 ; 1 vol. in-8 br., recueil de coupures de presse relatant les représentations et les concours d’art du «Théâtre d’art» de Bordeaux de 1936 à 1939 (avec qq. autres dates dont 1947 et 1948) ; 1 vol. grand in-8, recueil de coupures de presse relatant les représentations et les concours d’art du «Théâtre d’art» de Bordeaux de mai 1968 à février 1975 ; 6 cahiers in-8 br., recueils manuscrits détaillant le déroulement des représentations du théâtre d’art de Bordeaux (avec noms des acteurs, et appréciation, et nombreux programmes) : Cahier n° 1: Recueils de septembre 1951 à juin 1952 ; Cahier n° 2: Recueil manuscrits du 13 septembre 1952 à décembre 1955 ; Cahier n° 3: Recueil de janvier 1956 à octobre 1959 ; Cahier n° 4: Recueil de novembre 1959 à décembre 1961 ; Cahier n° 5: Recueil de janvier 1962 à février 1965 ; Cahier n° 6: Recueil de mars 1965 à janvier 1971 ; Cahier n° 7: Recueil de février 1971 à janvier 1976 ; Album photo de représentations du Théâtre d’Art de Bordeauxdont : La Mascotte ; La Passion ; Les Saltimbanques ; Le Pays du Sourire ; L’Avare. Dimanche 16 Novembre 1947 à 14 h 30 Salle Saint-Genès - On joint un lot de photos diverses dont photos de jeunesse de Charles Chabret (cliché Lascaux) et de Line Georges ; Exceptionnel lot d’une centaine d’affiches du «Théâtre d’art de Bordeaux», tous formats : Topaze, Caudéran, 4 décembre 1959 ; Pêcheurs d’Islande, 13 février 1944 (avec Any Sern) ; Les Saltimbanques, Bassens, 5 mars 1944 ; La Boîte à Biscuits, 1965, avec Line Georges ; Jean dans la Lune, Salle Saint-Genès, 1956 ; Miss Helyett, Salle Saint-Genès, janvier 1951 ; Fanfan la Tulipe ; L’Oiseau Bleu, 1942 ; Mam’zelle Nitouche ; Les Cloches de Corneville, Habas, 5 juillet 1942 ; La Veuve Joyeuse 1953 ; Pissenlit, Salle Franklin, 3 Janvier 1943 ; Rêve de Valse ; Fête des Mères, Grand Amphithéâtre de l’Athénée Municipal 6 juin 1953 ; Les Misérables, 1953 ; - Fédération Nationale des Combattants de moins de Vingt Ans. Congrès National. Primatiale Saint-André, mai 1952 ; La Comtesse Maritza, 13 novembre 1953 Salle Saint-Genès ; La Mascotte, 19 avril 1953 Salle Saint-Genès ; La Passion, mars 1945 ; Le Don d’Adèle, Barbezieux, 1957 ; Le Voyage de Monsieur Perrichon, 12 novembre 1950 ; La Belle Légende de l’Oiseau Bleu, Grand Théâtre, 28 Mai 1942 ; C’est pour Rire ; Ma Tante d’Honfleur, 1944 ; Pimprenette, Salle Franklin, 17 décembre 1944 ; La Cocarde de Mimi Pinson, Bassens 1944 ; La Corde Magique, 2 Mai 1954 ; L’Arlésienne, Salle St Genès ; La Fleur d’Oranger, Salle Franklin, 4 février 1945 ; Les Cloches de Corneville, Bassens, 1943 ; Gala de la «Vie Bordelaise» 1954 ; L’Avare, Arcachon, 1952 ; Le Grand Mogol, 30 Décembre 1945 ; Ces Dames aux Chapeaux Verts, Mademoiselle de la Seiglière, Coup de cœur, Barbezieux, 1950 ; J’y suis, j’y reste, 16 Février 1969, Salle du Grand Parc ; Mam’zelle Nitouche, Lugos, 1942
Le «Théâtre d’art de Bordeaux», anciennement «Théâtre d’art Charles Chabert», fut fondépar Charles Chabert en mai 1936. Pendant près de 40 années, cet important théâtre amateur forma un nombre considérable de comédiens ou d’artistes en devenir. On peut lire sur une affiche ancienne (vers 1936-1940) du Théâtre d’art Charles-Chabert: «Le théâtre d’art Charles Chabert a pour but principal de représenter de nouvelles œuvres dramatiques et lyiques. Les auteurs et compositeurs sont priés d’adresser leurs manuscrits [ … ] au siège du Théâtre d’Art. Les personnes désirant se produire dans les concerts, comédies, opérettes, revues, etc… sont priées de se faire connaître. Cours Artistiques Gratuits»
HISTOIRE GÉNÉRALE ILLUSTRÉE DU THÉATRE. avec la collaboration de Jacques De Montbrial et de Madeleine Horn-Monval. Tomes 1-5
Paris Librairie de France, 1931-1934 1931 in 4 (28x22,5) 5 volumes reliures demi chagrin marron de l'éditeur, dos lisses ornés, plats supérieurs titres en lettres dorées dans un encadrement estampé à froid, V et 236 pages [2], 300 pages, 269 pages, 296 pages, 438 pages, avec de trés nombreuses reproductions documentaires in texte et de 83 planches hors texte, dont 25 en couleurs. Tome 1: Le théâtre grec - Le théâtre latin. Tome 2: Le théâtre des miracles et des mistères - Le théâtre espagnol - Le théâtre italien. Le théâtre profane au Moyen Âge. Tome 3: Le théâtre anglais - Le théâtre français. Tome 4: Le théâtre français - Le théâtre européen au XVIII siècle. Tome 5: Le théâtre français - Le théâtre européen. Une des plus importantes études sur le théatre à toutes les époques et dans tous les pays (Théatre grec, latin, mystère du moyen-age, théatre libre etc). Lucien Dubech, 1881-1940. Ensemble en bel état, reliures décoratives de l'éditeur ( Photographies sur demande / We can send pictures of this book on simple request )
Très bon Couverture rigide
 Write to the booksellers
Write to the booksellers